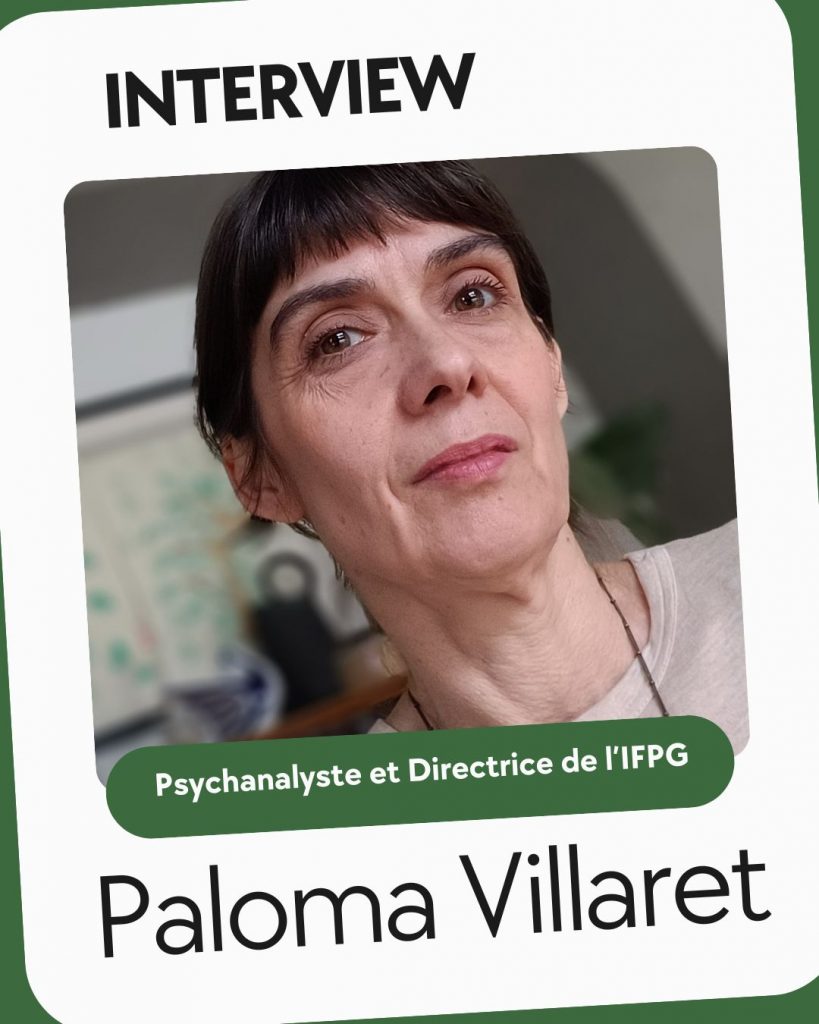Interview avec Mme Villaret, psychanalyste et formatrice aux Instituts Freudiens de Psychanalyse et directrice de l’Institut de Freudien de Psychanalyse Grenoblois
Question* : Dr. Delacroix, pouvez-vous nous expliquer ce qui pousse quelqu’un à vouloir devenir psychanalyste aujourd’hui ?
Mme Villaret : C’est une question fondamentale. Devenir psychanalyste n’est pas un choix de carrière comme les autres. C’est souvent l’aboutissement d’un cheminement personnel, d’une rencontre avec l’inconscient – le sien d’abord – qui suscite le désir de comprendre et d’accompagner la souffrance psychique d’autrui. Contrairement à d’autres professions de santé mentale, la psychanalyse exige une transformation profonde de celui qui souhaite l’exercer.
Q : Justement, parlons de cette formation si particulière. Combien de temps faut-il pour devenir psychanalyste ?
Mme Villaret : La formation complète s’étend sur cinq années minimum. Nous structurons cette formation en deux grandes phases : trois années d’enseignement théorique et pratique, suivies de deux années supplémentaires consacrées à la rédaction d’un mémoire de fin de formation.
Q : Que comprennent ces trois premières années d’enseignement ?
Mme Villaret : Ces trois années constituent le socle de la formation. Elles articulent trois piliers indissociables. D’abord, l’enseignement théorique : nos étudiants suivent des séminaires approfondis sur les concepts fondamentaux – Freud bien sûr, mais aussi Klein, Winnicott, Bion et bien d’autres. Nous couvrons la métapsychologie, la technique psychanalytique, la psychopathologie psychanalytique, l’histoire de la psychanalyse.
Ensuite, l’étude de cas pratiques. C’est absolument crucial : nos étudiants analysent des cas cliniques détaillés, participent à des groupes de pratique, apprennent à manier les concepts théoriques face à la réalité clinique. Cette approche leur permet de comprendre comment la théorie s’incarne dans la pratique.
Q : Et le troisième pilier ?
Mme Villaret : La lecture intensive d’ouvrages de référence. Nous exigeons de nos étudiants qu’ils se confrontent directement aux textes fondateurs. Pas seulement des manuels ou des résumés, mais les œuvres complètes de Freud. Cette lecture est accompagnée, commentée, mais elle reste un travail personnel exigeant. Un psychanalyste doit avoir une connaissance intime de ces textes.
Q : Ces trois années semblent déjà très denses. Pourquoi deux années supplémentaires ?
Mme Villaret : Ces deux années de mémoire sont fondamentales. Elles permettent à l’étudiant de développer sa propre réflexion, de croiser théorie et pratique dans un travail personnel approfondi. Le mémoire n’est pas un simple exercice académique : c’est l’occasion pour le futur psychanalyste de montrer qu’il a intégré les concepts, qu’il peut les questionner, les articuler à sa pratique naissante.
C’est aussi le moment où l’étudiant commence souvent à recevoir ses premiers patients. Cette période est cruciale pour l’intégration des apprentissages et le développement d’un style personnel.
Q : Vous n’avez pas encore mentionné ce qui est souvent présenté comme l’élément le plus important : la psychanalyse personnelle…
Mme Villaret : Vous avez raison, et c’est volontaire. La psychanalyse personnelle n’est pas un « élément » de la formation parmi d’autres : c’est son cœur, sa condition sine qua non. Impossible de devenir psychanalyste sans avoir soi-même fait l’expérience de l’analyse.
Q : Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette exigence est si absolue ?
Mme Villaret: Pour plusieurs raisons essentielles. D’abord, comment peut-on accompagner quelqu’un dans l’exploration de son inconscient si l’on n’a pas soi-même exploré le sien ? Comment peut-on comprendre les résistances, les transferts, les mécanismes de défense si on ne les a pas expérimentés dans sa propre chair ?
Ensuite, la psychanalyse personnelle permet de faire l’expérience de ce que vit le patient : l’angoisse des séances, la difficulté de la parole libre, les moments de révélation… Cette expérience est irremplaçable pour développer l’empathie nécessaire à l’exercice.
Q : Y a-t-il d’autres dimensions à cette analyse personnelle ?
Mme Villaret : Absolument. Elle permet de travailler sur ses propres points aveugles, ses zones de vulnérabilité. Un psychanalyste non analysé risque de projeter ses propres conflits sur ses patients, de ne pas entendre certains contenus parce qu’ils résonnent trop avec sa propre problématique.
L’analyse personnelle enseigne aussi l’humilité. Elle montre que la guérison n’est jamais définitive, que l’inconscient reste toujours actif. Cette expérience protège de la toute-puissance et maintient le psychanalyste dans une position d’humanité partagée avec ses patients.
Q : Combien de temps dure cette analyse personnelle ?
Mme Villaret : Il n’y a pas de durée standard. Le psychanalyste didactique (psychanalyste expérimenté qui accompagne les élèves psychanalystes dans leur analyse) détermine, en dialogue avec l’élève quand l’analyse de celui-ci est suffisamment aboutie pour recevoir des patients, L’analyse est un processus ouvert, qui accompagne toute la carrière car en tant que psychanalyste nous avons l’obligation d’être supervisé régulièrement.
Q : Cette formation semble très exigeante. Y a-t-il des prérequis ?
Mme Villaret : Au-delà des diplômes nous évaluons surtout la motivation, la capacité de remise en question, l’aptitude à supporter l’incertitude et l’ambiguïté. La psychanalyse n’est pas une science exacte : il faut pouvoir vivre avec le doute, l’interprétation, le non-savoir.
Q : Un dernier mot sur l’évolution de cette formation ?
Mme Villaret : La formation psychanalytique reste fidèle à ses exigences fondamentales, mais elle s’adapte aux réalités contemporaines. Nous intégrons davantage les apports des neurosciences, nous nous ouvrons aux questions de genre, d’interculturalité. Nous travaillons aussi sur de nouvelles modalités : groupes en ligne, tout en préservant l’essentiel : la rencontre humaine et la transmission vivante de la psychanalyse.
La psychanalyse a plus de cent ans, mais elle reste étonnamment actuelle pour comprendre les souffrances de notre époque. Former de nouveaux psychanalystes, c’est assurer la transmission de cet héritage précieux tout en l’adaptant aux défis du présent.
*Les questions ont été sélectionnées parmi celles posées par les personnes en recherche d’une formation de qualité en psychanalyse

« Cette formation m’a transformé autant qu’elle m’a formé »
Témoignage de Sarah M., 32 ans, étudiante en 5ème année de formation psychanalytique
Quand on me demande ce que m’a apporté cette formation en psychanalyse, je ne sais jamais par où commencer tant l’expérience a été riche et transformatrice. Après cinq années d’immersion dans cet univers, je peux dire que je ne suis plus la même personne qu’au début.
Un socle théorique progressif et solide
Les trois premières années ont constitué une véritable initiation. Je me souviens de mon premier cours sur Freud – j’avais l’impression de découvrir un continent inexploré. Les concepts étaient denses, parfois déroutants, mais nos formateurs ont eu l’intelligence de nous les présenter progressivement.
Ce qui m’a frappée, c’est la cohérence du parcours. Nous avons d’abord exploré les fondements avec Freud – l’inconscient, le refoulement, les instances psychiques. Puis nous avons approfondi avec les post-freudiens : Klein et son monde d’objets internes, Winnicott et ses objets transitionnels. Chaque auteur apportait sa pierre à l’édifice,.
J’ai particulièrement apprécié l’articulation entre théorie et clinique. Nos enseignants ne nous présentaient jamais un concept dans l’abstrait – ils l’illustraient toujours par des vignettes cliniques qui donnaient vie aux notions les plus complexes.
Un rythme qui permet l’assimilation
Les trois ans de socle théorique m’ont permis de vraiment m’imprégner des concepts. Entre les cours, j’avais le temps de relire, de réfléchir, de laisser les idées décanter. Nos formateurs nous encourageaient d’ailleurs à prendre ce temps : « Un concept psychanalytique, ça ne se comprend pas du jour au lendemain, ça se vit et se révit ».
Le mémoire : un travail d’appropriation personnelle
Les deux années consacrées au mémoire représentent selon moi le cœur de la formation. C’est là que tout bascule, où l’on passe du statut d’étudiant à celui de praticien en devenir.
Mon mémoire porte sur « L’angoisse de séparation chez l’adolescent : une lecture psychanalytique des conduites à risque ». Ce travail m’a demandé un investissement considérable, mais il m’a permis de croiser mes connaissances théoriques avec ma pratique naissante – j’avais commencé à recevoir quelques jeunes patients, sous le regard attentif de mon superviseur évidamment.
Rédiger ce mémoire, c’est apprendre à penser par soi-même, à développer sa propre réflexion clinique tout en s’appuyant sur l’héritage de nos prédécesseurs. C’est un exercice exigeant mais passionnant, qui m’a donné confiance en ma capacité à exercer cette profession.
Une transformation personnelle et professionnelle
Au terme de ces cinq années, je mesure le chemin parcouru. Cette formation m’a appris bien plus qu’un métier – elle m’a appris à penser autrement, à écouter différemment, à me situer face à la souffrance d’autrui avec plus de justesse.
Je suis devenue plus tolérante à l’ambiguïté, plus patiente face à la complexité humaine. J’ai appris que l’efficacité ne se mesure pas toujours en résultats immédiats, que parfois il faut savoir accompagner sans précipiter.
Cette formation m’a aussi rendue plus humble. Face à l’immensité de l’inconscient et à la singularité de chaque être humain, on apprend vite ses limites. C’est paradoxalement rassurant : on n’a pas à tout savoir, à tout comprendre, à tout guérir.
Vers l’exercice professionnel
Aujourd’hui, alors que je m’apprête à soutenir mon mémoire et à commencer ma pratique, je me sens à la fois prête et consciente du chemin qui reste à parcourir. Car devenir psychanalyste, ce n’est pas un processus qui s’arrête avec l’obtention d’un diplôme – c’est un devenir permanent.